EXTRAITS CRITIQUES
Un documentaire vibrant qui traque, au travers des saisissants paysages de Patagonie, la mémoire blessée du Chili. […]
Il y a aussi la mémoire des victimes de Pinochet, tous ces disparus, ces crimes non jugés et non punis, ces cadavres de torturés, lestés d’un rail, qui furent jetés à la mer par hélicoptère. Guzmán filme l’exhumation d’un de ces rails couverts de rouille et de coquillages, près duquel on a retrouvé un bouton de nacre – peut-être celui d’un supplicié.
Prosaïsme et poésie pure
Le réalisateur alterne le prosaïsme (entretiens avec l’historien Gabriel Salazar ou le poète Raúl Zurita, tous deux torturés) et la poésie pure (extraordinaires vues aériennes de la Patagonie, plans rapprochés sur l’eau, les glaciers, les cristaux de quartz…), le quotidien d’ici-bas et l’éternité du cosmos, la fragilité humaine et la permanence des éléments.
Il fait coexister la logique humaniste du citoyen et l’intuition aléatoire du rêveur, les vitesses asynchrones de l’horloge biologique et de l’horloge géologique, relie ces éléments hétérogènes par l’histoire et la topographie de son pays et par la ferme douceur de sa voix, aboutissant à un film d’une beauté et d’une liberté souveraines.
Puissante aventure des sens
Avec Guzmán, il faut oublier toutes les idées reçues sur le documentaire. Entre Nostalgie de la lumière et ce Bouton de nacre, il a l’art d’emmener ce genre dans des détours singuliers, surprenants, inédits, nous embarquant dans une fragile et pourtant puissante aventure des sens, de la mémoire et de la pensée.
Serge Kaganski, Les Inrockuptibles
Pour Guzmán lui-même, cet inlassable accaparement par l’histoire de son pays était aussi, sans doute, une manière pour l’exilé de revenir par procuration dans le cours d’une histoire, tout à la fois intime et nationale, dont il avait été violemment arraché.
Qui ne pourra jamais dire, à moins de l’avoir vécu dans sa chair, ce qu’est ce sentiment de l’exil ? Cet arrachement brutal à soi-même, cette lancinante souffrance de ne plus pouvoir habiter le monde auquel on était destiné, cette habitude à prendre de vivre perpétuellement ailleurs que chez soi. Cette rupture peut pourtant dévoiler une face solaire : la mise à distance du nationalisme, la découverte du monde et de soi-même comme altérité, la célébration plurivoque et universelle de la vie. Si l’on s’en tient à ce que montre son cinéma, on émettra l’hypothèse que Patricio Guzmán est entré depuis peu dans cette phase solaire, douce, pacifiée de l’existence diasporique. Que l’esprit de l’exil le tenaille moins qu’il ne l’inspire, lui insufflant une manière différente de regarder le monde. […]
Entre ces deux boutons, le film nous raconte l’histoire d’une extermination continue, mais redonne figure aussi à une vision du monde scintillante, conçue par des hommes déguisés en esprits (photographies hallucinantes de l’Autrichien Martin Gusinde) qui pensent que les morts se transforment en étoiles. S’y adjoignent les témoignages de quelques rares survivants (Cristina Calderón, dernière représentante de l’ethnie Yagán), d’un philosophe (Gabriel Salazar), d’un poète (Raúl Zurita), d’une artiste (Emma Malig).
Tels ces indiens assassinés qui nomadisaient au fil d’une eau qui porte leur mémoire, tels ces crucifiés océaniques de l’ère Pinochet transsubstantiés en coquillages nacrés, Patricio Guzmán invente pour ce film une alchimie qui réconcilie la science et la poésie, le rêve et la connaissance. Comme s’il voulait rendre un hommage en retour au plus cinéaste des philosophes, Gaston Bachelard, qui avait intitulé comme suit son fascinant ouvrage écrit en 1942 : L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière.
Jacques Mandelbaum, Le Monde
Un « Bouton » cousu de fil blanc
Le documentaire du Chilien Patricio Guzmán séduit par sa beauté mais abuse de raccourcis historiques gênants.
Pris séparément, presque chaque segment du film est fascinant, original, capable d’interroger ou d’émerveiller.
Seul un grand documentariste peut passionner et émouvoir avec le gros plan d’un bloc de quartz, un filet d’eau qui chante, un iceberg flottant. Le Bouton de nacre part de l’eau, apportée des comètes, lien entre la Terre (avec ses habitants) et le cosmos. La mer, interminable frontière du Chili, est vie, mais elle est aussi linceul. Délire pseudo-scientifique ? Peut-être, mais inscrit dans un continuum séduisant, où s’imbriquent la poésie, l’art, la linguistique et la recherche historique.
Pris séparément, presque chaque segment du film est fascinant, original, capable d’interroger ou d’émerveiller. Les derniers survivants des peuples premiers de Patagonie, dont la langue et la vision du monde disparaîtront bientôt avec eux ; les photos prises par les missionnaires au XIXe siècle, témoignages de la splendeur d’une culture qu’ils s’empresseront d’anéantir ; la glaçante reconstitution du modus operandi pour se débarrasser des cadavres des suppliciés sous la dictature de Pinochet. La construction intellectuelle, fluide et virtuose, ne tarde pas pourtant à céder la place à un malaise. Pour lier ces éléments, Patricio Guzmán use de syllogismes. Un exemple : l’île Dawson, où les religieux parquaient les Patagons, sera un siècle plus tard une prison pour les ministres de Salvador Allende. Conclusion : indigènes et partisans de l’Unité populaire sont victimes des mêmes bourreaux. Le raccourci est abrupt et manichéen. Idem avec le bouton de nacre du titre, verroterie irisée que les colons offrent en échange d’un groupe d’aborigènes qu’ils emmènent à Londres en 1830. Par un tour de passe-passe un peu trop voyant, le bouton réapparaîtra pour refermer la boucle (c’est certes la fonction d’un bouton). L’architecture forcée affaiblit le propos, mais ne retire rien à l’obsédant pouvoir de certaines images.
François-Xavier Gomez, Libération
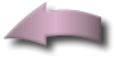
SYNOPSIS
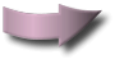
PROPOS DU REALISATEUR