COLINE GRANDO
Née à Paris en 1989, Coline Grando a grandi à Marseille. à 18 ans, elle intègre une classe préparatoire littéraire avec option cinéma en Avignon. En 2010, elle rentre à l'Institut des Arts de Diffusion (IAD), une école de cinéma belge. Elle en sort en 2015 avec un Master Réalisation et un film de fin d'étude Les Saisons, court-métrage de fiction. La Place de l’homme est son premier long-métrage documentaire. Le film questionne la place du partenaire dans une situation de grossesse non-prévue à travers le récit de 5 hommes entre 20 et 40 ans: la réalisatrice y pose un regard sur les relations femme-homme. En 2019, elle continue d’explorer l’avortement mais cette fois-ci du point de vue des médecins qui le pratiquent avec Les mains des femmes, commandé par la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial et le Centre Vidéo de Bruxelles (CVB). Le film donne la parole aux médecins sur leur pratique. Que ressentent les médecins qui pratiquent des avortements ? Pourquoi le font-ils ? Qu'en retirent-ils ? Où se situent leurs peurs mais aussi leurs convictions ? Son nouveau film Le Balai Libéré, questionne l'autogestion et les conditions de travail actuelles auprès de deux générations de travailleurs et travailleuses qui ont nettoyé un même lieu, l'université de Louvain-la-Neuve à 45 ans d'intervalle. Petite-fille de nettoyeuse, elle a enquêté sur le mouvement d’autogestion le balai libérédont elle ignorait l'existence....
DP et Wikipedia
Si le va-et-vient entre la réalité d’hier (l’autogestion a perduré 15 ans) et celle d’aujourd’hui (réticences dubitatives du personnel dépolitisé mais aussi du délégué syndical) assure le tempo, le documentaire fait alterner aussi les mini-séquences où la caméra met l’accent sur la solitude (voyez cet homme astiquant salles et sanitaires, cette femme harnachée de son aspirateur, cette autre préparant son matériel roulant, cette autre si minuscule dans l’immensité d’un amphi, et pendant la pause dans l’exiguïté d’un local avec une tasse pour seule compagne!)et ces rencontres sous forme de tables rondes où chacun.e s’exprime en toute liberté tout en étant à l’écoute de l’autre.
Blog Mediapart, Colette Lallement-Duchoze
CONTEXTE
Le 25 février 1975, les ouvrières de la société Anic qui assurait le nettoyage des locaux de l’Université catholique de Louvain (aujourd’hui UCLouvain) sur le campus fraîchement inauguré mais encore partiellement en chantier de la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve se mettent en grève. Quand elles arrivent à la caravane-bureau où commence leur journée de travail, qu’elles cherchent à pointer comme tous les matins, elles découvrent, avec stupéfaction pour certaines, que la pointeuse a disparu ! Le mouvement social s’ancre dans des mécontentements passés (salaires inférieurs à la moyenne, frais de déplacements non payés, périodes de travail régulièrement non déclarées, abus de pouvoir d’un contremaître, mépris de classe de la part du personnel de l’université, etc.) mais la goutte qui fait déborder le vase est la décision du patron d’envoyer une vingtaine d’entre elles travailler à Recogne, à plus de 120 km de leur lieu de travail initial. Dans le contexte de l’après Mai 1968 – et même si le Mai 1968 belge a été plus calme, moins radical que le Mai 1968 français – et d’une remise en cause du rôle « cogestionnaire » des syndicats, le « contrôle ouvrier » et l’« auto-gestion » sont dans l’air du temps ou alimentent en tout cas les débats, tant au sein des syndicats que parmi les intellectuels et artistes qui cherchent à se rapprocher des luttes ouvrières. Après quelques jours d’impasse de la grève des ouvrières d’Anic, le patron refusant – comme presque toujours – de discuter tant que la grève durera et que le travail n’aura pas repris, les nettoyeuses entourées de syndicalistes de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de militants liés au Mouvement ouvrier chrétien (MOC) se réunissent en groupes de travail et finissent par décider de licencier leur patron et d’aller proposer à l’UCL – soutenues par des étudiants et même des professeurs émérites étrangers comme l’économiste Jaroslav Vaněk, qui présentent le projet à l’université comme une belle opportunité d’expérience en sciences sociales à l’échelle 1/1 – de reprendre le travail en tant qu’association sans but lucratif autogérée.
pointculture.be, Philippe Delvosalle
SYNOPSIS
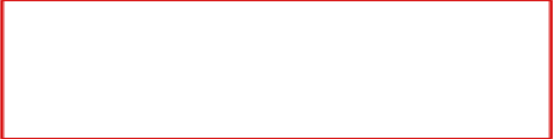
Dans les années 70, les femmes de ménage de l’université catholique de Louvain (UCL) mettent leur patron à la porte et créent leur coopérative de nettoyage, Le Balai libéré. 50 ans plus tard, le personnel de nettoyage de l'UCLouvain rencontre les travailleuses d'hier et tentent de comprendre comment cela a pu être possible et si cela serait envisageable à notre époque.

Extraits critiques

Le balai libéré